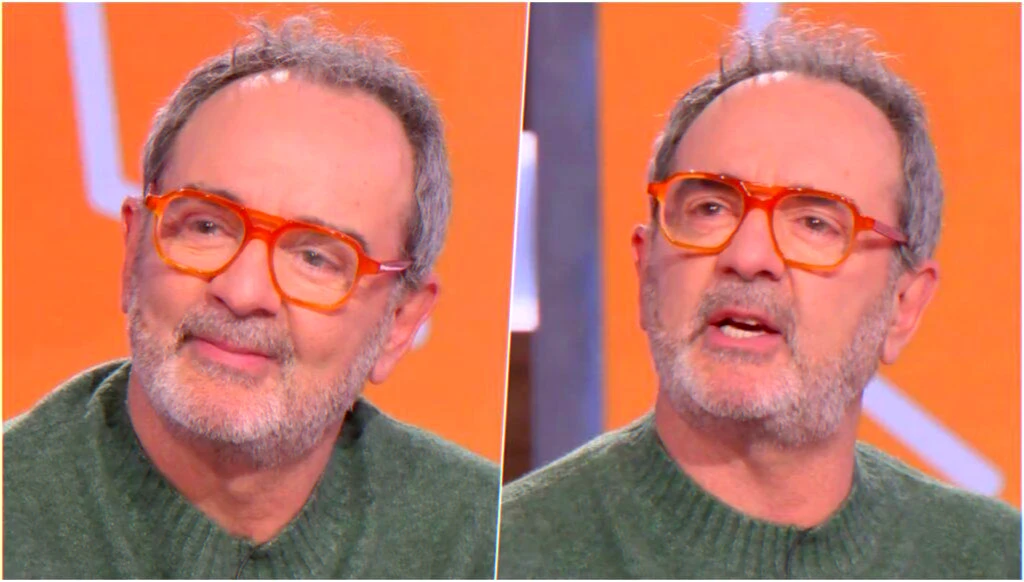Ce 8 septembre, le sort judiciaire a tourné pour deux journalistes spécialisées sur des zones de conflit. Édith Bouvier et Céline Martelet ont choisi de ne pas faire appel après leur condamnation en première instance. Elles ont été condamnées à 10 et 12 mois d’emprisonnement assortis du sursis simple pour financement du terrorisme.
Deux trajectoires, une même obsession pour le terrain
Les trajectoires d’Édith Bouvier et de Céline Martelet se rejoignent sur un point : toutes deux ont fait du terrain leur marque de fabrique. Édith Bouvier est journaliste indépendante et spécialiste du Moyen-Orient. Elle a notamment été blessée par un bombardement en Syrie en 2012, un événement qui a marqué sa pratique du reportage de guerre.
Céline Martelet, quant à elle, a été grand reporter pour RMC puis BFM TV. Depuis plus d’une décennie, elle concentre ses enquêtes sur le terrorisme. Leur connaissance fine des zones concernées et des acteurs locaux a logiquement favorisé leur collaboration éditoriale : en 2018, elles ont co-signé Un parfum de djihad (éditions Plon), puis, en 2022, Le cercle de la terreur (éditions Plon), une vaste enquête menée en France, en Syrie et en Irak autour de la question lancinante : « Sommes-nous en train de fabriquer les terroristes de demain ? »
Des gestes humanitaires ou des actes répréhensibles ?
Le dossier qui a été soumis aux juges en 2024 porte sur des actes jugés ambivalents et controversés. Les deux journalistes ont été jugées à Paris pour avoir transféré des fonds destinés à payer des passeurs afin d’« exfiltrer » plusieurs femmes de zones contrôlées par les groupes djihadistes en Syrie et en Irak. Elles ont également été mises en cause pour leur participation à l’opération de sauvetage ratée du djihadiste Maximilien Thibaut.
Face à la cour, Édith Bouvier et Céline Martelet ont reconnu être « sorties du cadre » de leur métier. Elles ont toutefois affirmé agir par « humanité », dans le but, selon elles, de « sauver des vies ». Dans leurs déclarations, elles ont insisté sur le fait qu’elles « n’avoir jamais financé le terrorisme » qu’elles combattent au quotidien par leur travail de journalistes.
La décision de ne pas faire appel et ses justifications
Plutôt que de poursuivre la procédure en appel, les deux femmes ont renoncé à contester la décision de première instance. Ce choix, loin d’être anecdotique, a été présenté par leurs avocats comme mûrement réfléchi. Ils ont déclaré : « C’est une décision qui a été réfléchie et qui découle d’une volonté d’apaisement de la part de toutes les parties. »
Les motifs exacts de cet apaisement n’ont pas été détaillés publiquement. Le contexte judiciaire reste sensible : la qualification de « financement du terrorisme » est lourde de conséquences juridiques et symboliques, et la question de la frontière entre action humanitaire et infraction pénale demeure au cœur du débat.
Conséquences et réactions
Cette affaire interpelle la profession et l’opinion publique. Des journalistes habitués aux zones de conflit se retrouvent poursuivis pour des gestes présentés comme humanitaires. Le cas relance le débat sur la marge de manœuvre des reporters sur le terrain, sur leurs obligations déontologiques et sur les risques encourus lorsqu’ils franchissent les limites légales, même au nom de la compassion.
Sur le plan personnel et professionnel, la décision de ne pas faire appel marque une étape lourde pour Édith Bouvier et Céline Martelet. Leurs ouvrages, publiés aux éditions Plon en 2018 et 2022, témoignent d’un engagement de longue date sur ces sujets. Mais la procédure pénale ouvre une nouvelle page, plus conflictuelle, dans leurs carrières.
Sans davantage d’éléments publics sur les pièces du dossier ou sur d’éventuelles discussions entre parties, plusieurs points restent entourés d’incertitude. Reste que, pour l’heure, la condamnation en première instance et le choix de ne pas l’avoir contestée marquent un tournant judiciaire et symbolique pour ces deux figures du reportage sur le terrorisme et le Moyen-Orient.