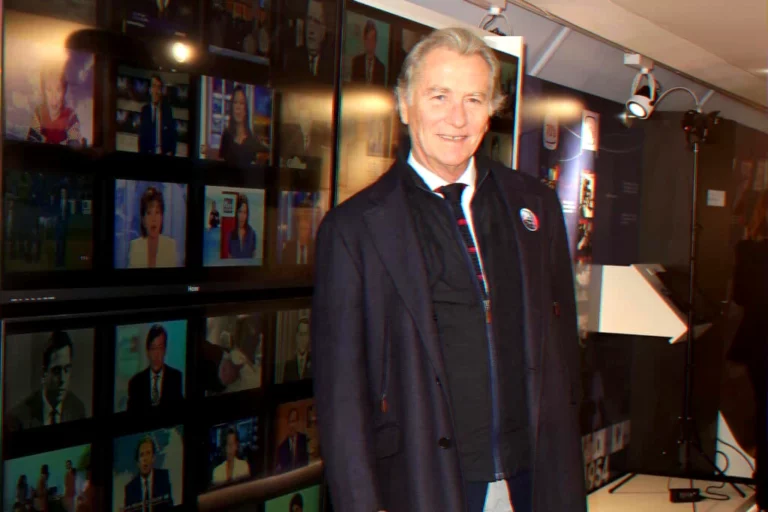Le 27 août 2025, alors que L’heure des pros traite habituellement de dossiers nationaux et de polémiques, Pascal Praud a recentré une séquence sur un sujet plus prosaïque : la baisse des pourboires dans les cafés et restaurants français. Le présentateur a ouvert le débat en évoquant une évolution des usages liée, selon lui, à la conjoncture et aux nouvelles habitudes de paiement.
Un constat posé à l’antenne
« Dans les cafés et restaurants, les pourboires se font de plus en plus rares. Baisse du pouvoir d’achat, paiement électronique généralisé… », a expliqué Pascal Praud lors de l’émission. Il a souligné que, désormais, certains établissements parisiens proposent des options pour verser un pourboire via carte bancaire, et que cette pratique donne parfois l’impression d’une obligation tacite : « D’ailleurs, on a l’impression d’être obligé de laisser 10% de plus sur la carte bleue ».
Ce rappel de l’évolution des modes de paiement et de la pression perçue autour du geste a servi de point de départ à un échange plus personnel entre les chroniqueurs présents sur le plateau.
Le témoignage d’Élisabeth Lévy et la réaction de Pascal Praud
Interrogée pour savoir si elle-même donnait des pourboires, Élisabeth Lévy a pris la parole : « Alors, pour être honnête, je dois avouer que j’ai encore à l’ancienne des pièces ». Elle a précisé sa pratique : « Dans les restaurants, j’ajoute sur la note. Mais je donne toujours, sauf si les gens ne sont vraiment pas sympathiques. Par exemple, un livreur m’a apporté aujourd’hui un gros colis et je lui ai donné un pourboire. Et un verre d’eau ! »
Lorsque Pascal Praud a appris le montant de ce geste — trois euros — il a réagi. D’un ton critique, il a appelé à la mesure : « Il faut faire attention : le pourboire, ce n’est pas la manche. C’est-à-dire qu’il faut que ce soit quand même conséquent. Si vous donnez à quelqu’un un ou deux euros… »
Face à cette mise en garde, Élisabeth Lévy a défendu son geste en rappelant le pouvoir d’achat actuel : « personne ne le fait. Avec trois euros, on peut se payer un café ». Mais Pascal Praud a maintenu sa position, confiant qu’il « n’irait pas donner un euro à un livreur qui vient chez moi ». Il a expliqué son refus par une question de dignité : « Je trouve ça humiliant, si vous me permettez de donner mon avis. Je préfère même ne rien donner ».
La discussion a laissé transparaître deux approches : l’une, pragmatique et axée sur un geste quotidien modulé par la sympathie du service ; l’autre, plus normative, appelant à une générosité « conséquente » pour que le pourboire conserve sa valeur symbolique.
Un débat aux tonalités contradictoires
Sur le plateau, le ton est resté mesuré, mais la confrontation des points de vue a révélé une tension sociétale : comment rémunérer un service supplémentaire sans basculer vers un réflexe imposé ? Le passage au paiement sans contact modifie les usages et les attentes. Pour certains, la facilité de laisser quelques centimes sur la carte décomplexe le geste ; pour d’autres, elle risque d’instituer une norme financière mal définie.
Les échanges ont aussi montré que le geste du pourboire conserve un aspect moral et symbolique. Pour Élisabeth Lévy, il s’agit d’un acte de reconnaissance ponctuel. Pour Pascal Praud, de petites sommes peuvent apparaître comme indignes et relever d’une logique de mendicité s’ils deviennent systématiques.
La séquence s’est achevée sans consensus, et la question de savoir si un pourboire de trois euros vaut mieux que rien a été laissée ouverte. « Peut-être faudrait-il demander son avis au livreur, la prochaine fois… », a conclu l’un des intervenants, soulignant l’absence sur le plateau des premiers concernés par ce débat : les travailleurs du service.
Le sujet, simple en apparence, renvoie à des interrogations plus larges sur les évolutions sociales et économiques liées aux modes de consommation. L’émission a choisi de l’aborder par la discussion et les anecdotes, laissant au public le soin de juger de la place et du montant des pourboires dans la vie quotidienne.